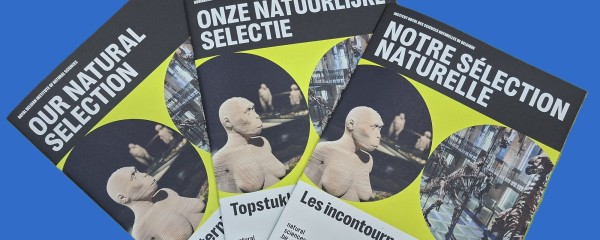Blessures d’accouplement des indices pour reconnaître les dinosaures femelles

Les paléontologues ont découvert un motif frappant de fractures dans les vertèbres caudales des dinosaures à bec de canard, qui pourraient s’être produites lors de l’accouplement. « Le poids du mâle pouvait écraser le dos de la femelle », explique Filippo Bertozzo de l’Institut des Sciences naturelles, premier auteur de l’étude. « Ces lésions peuvent nous aider à identifier les dinosaures femelles. »
Une nouvelle étude menée par une équipe internationale de paléontologues dirigée par le Dr Filippo Bertozzo, de l’Institut des Sciences naturelles de Belgique, décrit une série de lésions osseuses traumatiques dans la queue de l’un des groupes de dinosaures les plus prospères : les hadrosauridés herbivores, dits “à bec de canard”.
Ces dinosaures, telles que le Parasaurolophus (rendu célèbre par les films Jurassic Park et Jurassic World) et le robuste Edmontosaurus, peuplaient la Terre à la fin du Crétacé, peu avant la fameuse extinction massive qui provoqua la disparition des dinosaures terrestres. Des os fossilisés d’hadrosaures ont été découverts dans le monde entier, faisant de ce groupe l’un des de ceux les mieux étudiés par les paléontologues.
Des recherches antérieures sur les pathologies des hadrosaures ont révélé une multitude de blessures et de maladies — traumatismes, infections, tumeurs et troubles du développement — montrant que la vie au Crétacé était rude, marquée par une lutte constante pour la survie.

(c) Filippo Bertozzo/iScience
Fractures cicatrisées
En 2019, lors d’une mission de recherche à Blagovechtchensk, en Russie, Bertozzo étudiait un grand hadrosauridé à crête ornementée, Olorotitan arharensis. Il remarqua que de nombreuses vertèbres caudales présentaient des fractures cicatrisées au niveau des apophyses épineuses. « Cette observation m’a intrigué », raconte Bertozzo. « J’avais déjà vu ce motif chez d’autres espèces similaires, mais seulement sur des vertèbres isolées. Ici, les fractures étaient clairement concentrées dans la partie supérieure de la queue, sans s’étendre jusqu’à la pointe. »
Bertozzo avait étudié les pathologies des dinosaures à bec de canard lors de sa thèse de doctorat à la Queen’s University de Belfast, sous la direction de la professeure Eileen Murphy et du Dr Alastair Ruffell, co-auteurs de l’étude. « C’est une situation vraiment particulière », souligne Murphy. « Souvent, lorsqu’on trouve une vertèbre provenant du haut de la queue d’un hadrosaure, elle présente une fracture cicatrisée. Le motif est clair, et nous avons voulu en comprendre la cause. »
L’hypothèse de l’accouplement
Depuis 1979, le co-auteur Darren H. Tanke collecte des restes d’hadrosauridés dans le Dinosaur Provincial Park (Alberta, Canada), dont plusieurs vertèbres caudales fracturées. Ces découvertes l’ont conduit, en 1989, à formuler une hypothèse pour expliquer ce curieux schéma pathologique. « Contrairement à d’autres dinosaures, les hadrosauridés présentent des fractures dans la partie de la queue proche de la probable position du cloaque », explique Tanke. « Cela m’a conduit à proposer que ces blessures avaient pu être causées involontairement lors de l’accouplement. »
À l’époque, son hypothèse reposait sur un nombre limité d’échantillons nord-américains et n’avait pas résisté à l’examen scientifique. Jusqu’à ce que Bertozzo le contacte en 2019 pour collaborer au projet. « Darren est le père de cette hypothèse », raconte Bertozzo. « Je n’oublierai jamais sa surprise quand je lui ai dit que j’avais trouvé le même motif chez d’autres hadrosauridés en dehors du Canada. »

Pression vers le bas
La nouvelle étude repose sur environ 500 vertèbres caudales pathologiques provenant de différentes espèces d’hadrosauridés d’Amérique du Nord, d’Europe et de Russie. Les lésions observées sont remarquablement similaires entre espèces : des fractures verticales à obliques, probablement causées par une pression verticale exercée sur la pointe de l’apophyse épineuse.
Une analyse statistique du jeu de données a été associée à une analyse par éléments finis (Finite Element Analysis), une technique d’ingénierie qui permet de prédire le comportement d’une structure soumise à des contraintes mécaniques, comme la flexion ou la rupture. Les résultats ont montré que les fractures correspondaient à une force appliquée de haut en bas, sous un angle de 30 à 60 degrés, provoquant une contrainte suffisante pour fracturer les longues apophyses des vertèbres caudales.
Comportement reproducteur complexe
« Une fois les résultats obtenus, nous avons envisagé tous les scénarios », explique le co-auteur Simone Conti : « prédation, tension musculaire lors des déplacements, collisions en groupe, ou encore des comportements rares comme les bains de boue observés chez les éléphants modernes. Au final, l’hypothèse de l’accouplement était la plus cohérente avec nos observations. »
Selon cette hypothèse, le poids du mâle s’exerçait sur la partie supérieure de la queue de la femelle, provoquant des fractures dues au stress mécanique. Ces blessures n’étaient pas mortelles : de nombreux spécimens présentent des signes de guérison, et certains même des récidives, preuve d’un comportement répété.
« Qu’un mâle blesse une femelle pendant la reproduction peut sembler désavantageux sur le plan évolutif », explique le professeur Gareth Arnott, co-auteur de l’étude, « mais nous observons des comportements similaires chez de nombreuses espèces actuelles, comme les otaries, les tortues ou certaines espèces d’oiseaux. La compétition reproductive reste l’un des sujets les plus complexes de la biologie animale — a fortiori chez des espèces éteintes. »
Les dinosaures femelles enfin identifiables
Ces découvertes ne constituent pas une conclusion définitive, mais ouvrent la voie à de nouvelles recherches. « Si l’hypothèse de l’accouplement est correcte », précise Bertozzo, « on peut en déduire qu’un individu présentant ces fractures était une femelle. Ce serait une avancée majeure, car cela permettrait d’explorer les différences entre mâles et femelles. Avaient-ils des crânes de formes différentes ? Pouvons-nous identifier des caractères sexuels distinctifs qui nous aideraient à comprendre la structure sociale des troupeaux d’hadrosaures ? »
Un élargissement de cette étude à d’autres groupes de dinosaures et à de nouvelles simulations informatiques pourrait encore approfondir notre compréhension du mode de vie de ces animaux disparus depuis des millions d’années.
L'étude est publiée dans la revue scientifique iScience.